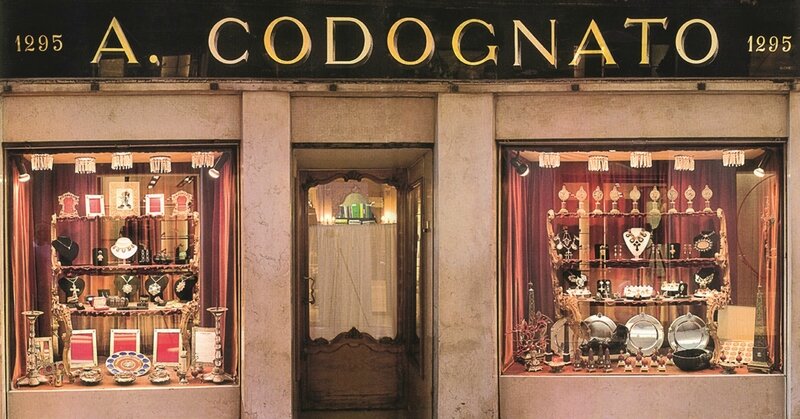Sauvaire, que mon grand-père connut, avait mis son peu d’argent dans ce petit carré de terre rouge ; il l’avait enfermé de murettes faites avec les pierres tirées de son champ. Il y avait planté des oliviers, des vignes, des amandiers. Il avait suivi jour après jour, heure par heure, la croissance de ses plantations. Pour la pause de midi, il avait creusé dans l’épaisseur de la muraille, un abri où il se mettait quand il pleuvait. Dedans, il s’était fait un siège avec une pierre plate, et un autre dehors bien ensoleillé, abrité du vent du Nord. Et pour la sieste, l’été, la terre était assez douce pour son corps, la terre où il avait mis tant d’amour.
De son champ il vit pousser la vigne et les arbres, il recueillit dans le creux de ses mains les premières amandes, celles qui sont comme du lait, et qu’on peut, sur un morceau de pain frais, offrir à un roi s’il passe sur le chemin.
…
Ô joie, simple orgueil : son champ le nourrissait ;
…
Ce champ fut toute la vie de Sauvaire. Tant qu’il eut la force de travailler, il s’y tint du lundi au samedi. Et le dimanche il restait au village. Il s’asseyait sur une chaise au bord du chemin et tirait longuement sur sa pipe en caressant des yeux, loin, bien loin, le velours profond des montagnes qui barrait la vue au ras du ciel.
Mais vint le temps où l’outil se fit plus lourd dans sa main. Pas d’enfant, pas de neveu, pour se charger de ce pauvre coin de terre.
Sans rien dire, le vieil homme y allait chaque jour, et par-ci, par-là, arrachait les herbes, piochait la longueur de trois pas, taillait une douzaine de souches, entretenait ce qui était toute sa vie. Mais l’herbe revenait toujours vivace, l’ivraie, fraîche de toute la rosée de la nuit, s’étendait, et les angles de terrain de plus en plus oubliés s’approchaient chaque mois du centre.
A grands pas, la vie sauvage reprenait la terre. Sauvaire se battit longtemps. Il avait trouvé l’énergie de venir même le dimanche, quand toutes les terres sont vides d’hommes, quand de trois lieues on peut entendre le chant du coucou dans un arbre et que l’heure méridienne sonne seule dans l’air chaud.
Il s’asseyait sur la banquette de pierre, le dos contre le mur, et ses yeux de ciel lavé regardaient sans fin le champ perdu. La paix de l’endroit était traversée par un papillon qui voltigeait, tout blanc au feu de l’air, et qui, enfin, allait se poser plus loin derrière une touffe de l’herbe. Il n’y avait dans l’air que le parfum du thym et des romarins.
Le temps s’en allait doucement, comme la chaleur dans ses veines. Dans la paix de l’après-midi, le sang battait à ses oreilles. Parfois, sans bruit, un perdreau apparaissait sur les pierres. Sauvaire restait silencieux, ne bougeait pas – ils étaient tous les deux à s’observer, retenant leur souffle, comme deux pierres au soleil. Puis l’autre s’envolait, laissant là, dans le silence de la lumière, Sauvaire abandonné du monde.
.
MAX ROUQUETTE
.
Oeuvre Serge Fiorio